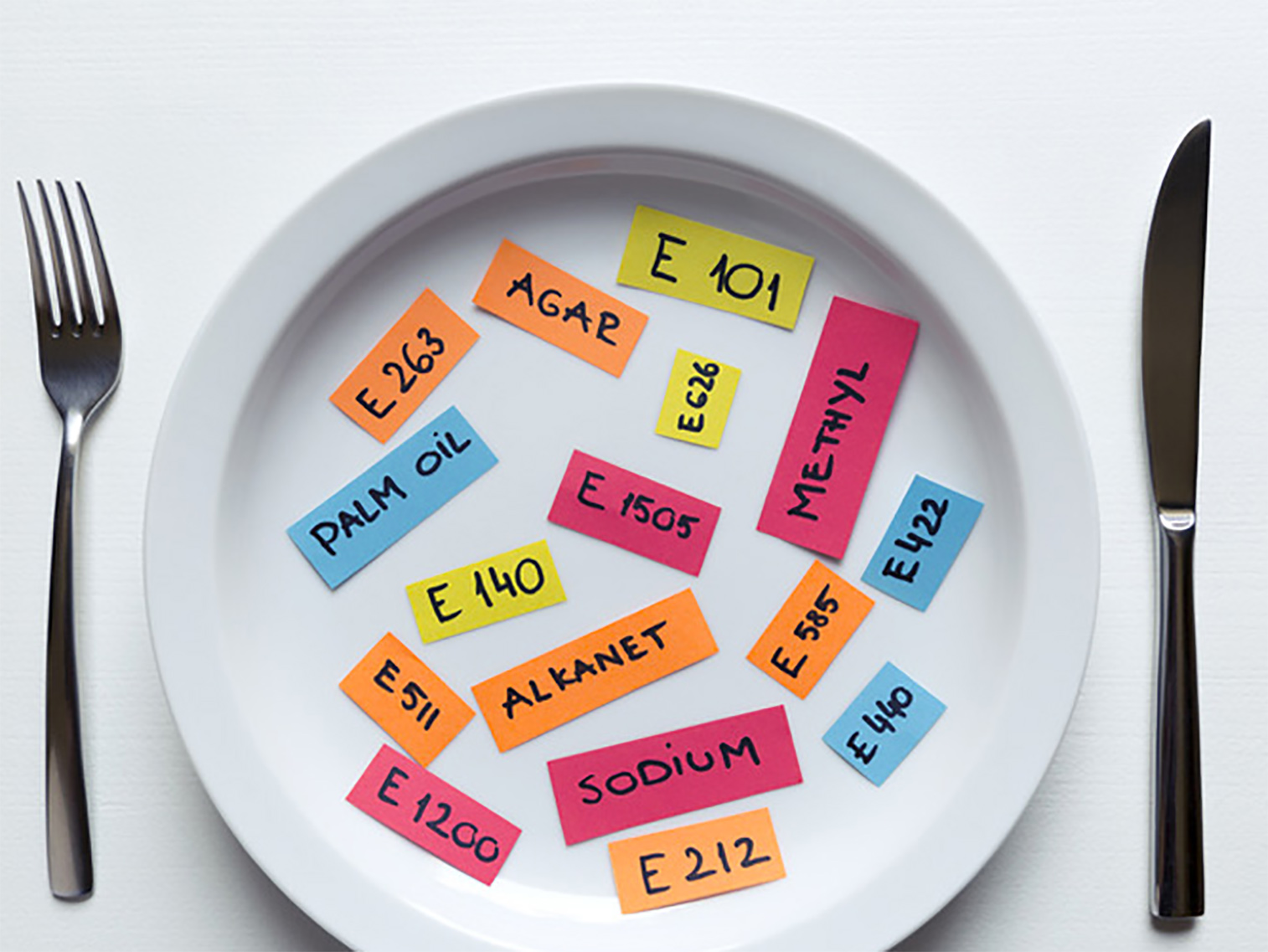
Additifs alimentaires, trop c’est trop
Publié le 07 mars 2019
On appelle additif alimentaire toute substance non consommée habituellement en tant qu’aliment en soi, qu’elle ait ou non une valeur nutritive...
Vendredi, jour des courses ! Rendez-vous dans votre grande surface favorite ! Je vous propose de vous livrer à un petit jeu : armez-vous d’une loupe, d’un petit carnet et d’un stylo et avant de mettre un article dans votre chariot, regardez l’étiquette et notez tous les « E quelque chose » que vous rencontrez et le nombre de fois que vous rencontrez le même additif.
Alors le résultat ? Vous répondez « zéro », passez votre chemin, sinon prenez le temps d’en apprendre un peu plus sur les additifs alimentaires.
Qu’est-ce qu’un additif alimentaire ?
On appelle additif alimentaire toute substance non consommée habituellement en tant qu’aliment en soi, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition intentionnelle dans une denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, a pour effet qu’elle devient un composant de cette denrée.
Additifs : de multiples fonctions
Le rôle majeur des additifs est un rôle organoleptique : ils permettent d’influer sur la forme, la couleur, la texture, la viscosité ou le goût des aliments. Exemple : colorants, exhausteurs de goût, gélifiants, etc.
Mais ils interviennent aussi sur la conservation des aliments comme les conservateurs ou les antioxydants et peuvent influer sur leur valeur nutritionnelle comme les édulcorants.
Attention ! Les arômes alimentaires ne sont pas considérés comme des additifs. Ils sont soumis à une réglementation qui leur est propre.
Des pratiques ancestrales détrônées par la chimie
De tout temps, l’homme a cherché à renforcer le goût des aliments, à les conserver, à améliorer leur présentation. Dès l’Antiquité, on savait utiliser le sel de mer pour conserver poissons et viandes. Au Moyen-Âge, le beurre était coloré grâce à des fleurs de soucis et cette pratique était déjà réglementée. Sur les côtes bretonnes, on fabrique depuis fort longtemps une sorte de flan en faisant épaissir du lait avec du goémon.
Mais c’est le boom de l’industrie agro alimentaire dans les 50 dernières années qui a révolutionné la nature de ces additifs, autrefois naturels, maintenant synthétiques et leurs conditions d’utilisation. Ils représentent désormais un marché considérable d’autant que grande distribution et consommateurs en redemandent : les aliments doivent se conserver le plus longtemps possible et il est scientifiquement prouvé que les couleurs vives sont plus vendeuses. Enfin, la production industrielle des additifs les a rendus beaucoup moins chers et souvent plus faciles à utiliser que les additifs naturels.
Additif alimentaire : une législation très stricte ? Oui, mais…
Le recours aux additifs est harmonisé depuis 2008 au niveau de l’Union Européenne par le règlement N° 1333/2008. Les additifs sont classés au sein de 26 catégories fonctionnelles.
Le règlement prévoit une liste des additifs autorisés qui seuls peuvent être employés. La liste précise qui recense pour quels aliments l’additif peut être utilisé et dans quelles conditions. C’est le principe de liste positive. La liste est en cours d’élaboration à partir des additifs autorisés dans les pays de l’UE, ceux-ci doivent tous être réévalués à partir des dernières données scientifiques.
Il n’est, par exemple, pas autorisé d’utiliser des colorants dans les pâtes alimentaires, le chocolat ou les confitures.
On n’est pas loin de 400 additifs autorisés à ce jour dans l’UE. Cette liste est réduite à une quarantaine de substances dans les produits issus de l’Agriculture biologique. Celle-ci autorise l’utilisation de 2 colorants, le charbon végétal et le rocou tous deux destinés à l’industrie fromagère contre une quarantaine pour la production conventionnelle.
Faut-il craindre les additifs ?
La loi peut sembler très protectrice pour le consommateur et très contraignante pour l’industrie. Pour qu’un additif puisse figurer sur la liste, il doit répondre à 3 conditions :
1/ Il doit respecter la santé du consommateur aux doses proposées : des évaluations toxicologiques sont réalisées sur l’animal pour déterminer une dose sans effet nocif qui sera divisée par 100 pour donner «la dose journalière admissible» (DJA) exprimée en mg/kg. Il existe donc une dose maximale autorisée pour une denrée alimentaire.
Mais si nous consommons de nombreux aliments transformés, nous pouvons absorber plusieurs dizaines d’additifs différents dont les effets conjugués (effets cocktails) ne sont pas connus, les études se faisant sur chaque additif séparément, de surcroit chez l’animal dont les réactions ne sont pas forcément similaires à celles de l’homme.
Petite histoire vraie d’un mercredi ordinaire
Angélique ne travaille pas le mercredi pour se consacrer à Léa et Antonin, 8 et 10 ans. Ce jour là, ce sont les enfants qui font le menu. Aujourd’hui, un sirop de menthe et une poignée de biscuits apéritifs soufflés, puis des nuggets de poulet avec des frites, une salade de tomates (c’est maman qui a insisté) et un yaourt aux fruits (il faut manger des produits laitiers et des fruits, les enfants l’ont appris à l’école). Angélique veut passer du temps avec ses enfants, alors pas question d’éplucher des patates, de faire des beignets de poulet ou de mélanger quelques fruits avec un yaourt nature, elle achète ces denrées toutes prêtes en grande surface. Mais c’est la semaine du goût et un intervenant est venu dans la classe d’Antonin, leur parler des additifs alimentaires. Alors Antonin s’amuse à regarder les étiquettes de leur repas et fait le compte : 33 additifs (10 colorants, 1 émulsifiant, 2 exhausteurs de goût, 4 correcteurs d’acidité, 3 poudres à lever, 7 épaississants, 3 stabilisants) rien que pour le repas de midi. Et dire qu’il y 52 mercredis dans une année.
Et vous faites, que faites-vous le mercredi avec vos enfants ?
De nombreuses études à travers le monde montrent que les additifs ne sont pas aussi inoffensifs que cela. Certaines substances utilisées pourraient au mieux induire des effets secondaires comme l’hyperactivité chez l’enfant, les allergies, la diminution de l’action bénéfique de certaines vitamines, au pire avoir des effets cancérigènes, neurotoxiques, voire tératogènes et la liste est longue… L’aspartame est l’un des plus étudiés et des plus controversés, selon ses détracteurs, ils pourraient être à l’origine de 600 symptômes différents alors qu’on le trouve dans de nombreux aliments et médicaments.
2/ Il doit exister un besoin technologique démontré par l’industrie agro-alimentaire, celle-ci doit prouver que l’adjonction est nécessaire et qu’il y a un bénéfice pour le consommateur. Est-ce réellement nécessaire d’ajouter un colorant vert au sirop de menthe ? Quels bénéfices, sinon pour l’industrie elle-même, pour laquelle les contraintes marketing et financières sont fortes ?
3/ On ne doit pas induire le consommateur en erreur, et ceci n’est pas toujours évident, un colorant peut laisser penser qu’un yaourt peut être aux fruits, alors qu’il est simplement aromatisé.
Additifs : Ils sont partout !
On les trouve dans les charcuteries, les viandes, poissons, crustacés en conserve, confiserie, sirops, sodas, plats préparés, les biscuits apéritifs, des milliers d’aliments et de nombreux médicaments sont concernés.
Étiquetage, tout est fait pour nous embrouiller !
La législation sur l’étiquetage semble claire : tous les additifs doivent être mentionnés dans la liste des ingrédients. Figurent dans l’ordre : le nom de la catégorie suivi soit du nom de l’additif, soit de son code E (pour Europe) suivi de son numéro.
Cela donne par exemple :
Colorant : Carmin, Exhausteur de goût : E621, ou
Colorant : E120, Exhausteur de goût : Glutamate Monosodique
L’énumération des additifs peut concerner plusieurs lignes dans la liste des ingrédients. L’industriel n’est pas tenu d’adopter une écriture unique et un additif peut être nommé par son nom et un autre par son code. Il est assez facile de trouver dans une liste des Exxxx, mais plus difficile de repérer en lecture rapide les noms officiels.
Devant la pression accrue des consommateurs et des associations qui les représentent, certains emploient des additifs naturels et les utilisent comme argument de vente. Mais devant une étiquette « Sans colorant », le consommateur baisse la garde, effectivement il n’y a pas de colorant, mais cela ne veut pas dire que le produit est exempt d’autres additifs.
– Naturel n’est pas synonyme d’inoffensif –
Ainsi, le cochenille ou carmin, E120 colorant naturel obtenu à partir d’insectes écrasés et présent dans de nombreux aliments (yaourts, bonbons, chewing gums, boissons sucrées) est l’un des plus décrié surtout pour les enfants.
Comment faire pour éviter les additifs ?
Privilégiez les produits non transformés ou le moins transformés possible, les additifs sont interdits dans les produits bruts.
Évitez le plus possible les sodas, en particulier les sodas light, ils contiennent très souvent de l’aspartame et entretiennent le goût pour le sucré. Optez plutôt pour des jus de fruits soit maison, soit 100% fruits.
Limitez la consommation de bonbons et autres confiseries à quelques occasions particulières.
Enfin, si vous êtes convaincu, achetez un petit livre pour en savoir plus sur les additifs et être en capacité d’identifier les plus dangereux quand vous faites vos courses.
Michèle SALORD
Conseillère en nutrition, alimentation et éducation au goût.
Mentions légalesCGVProtection des donnéesGestion des cookiesIndex égalitéAlerte éthique ©2025 Potager City - version 2.18.1.7